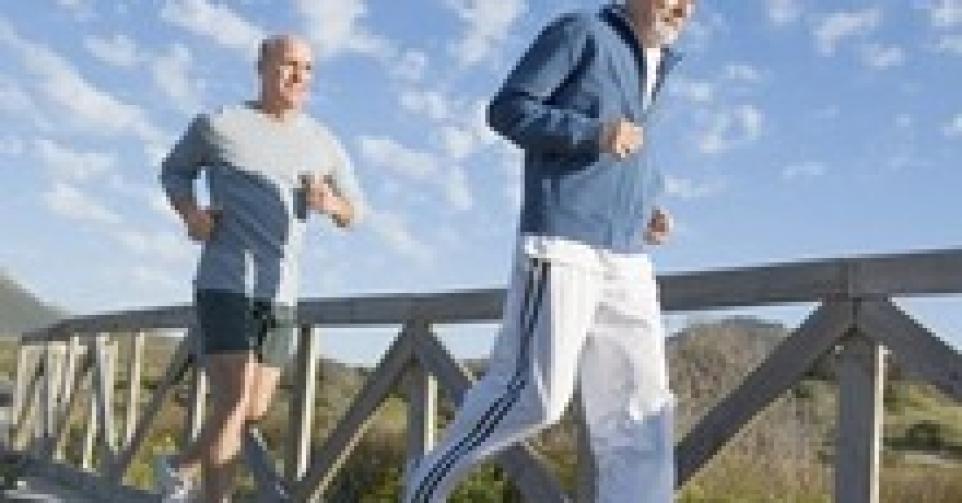
Une nouvelle hanche pour bouger comme avant
En l’espace de dix ans, la pose d’une prothèse de la hanche est devenue une routine. Les techniques et les matériaux ont tellement évolué qu’on peut désormais proposer des interventions sur mesure. A l’heure actuelle, en Belgique, le chirurgien dispose de pas moins de 1.092 solutions !
Une prothèse de la hanche se compose de deux parties : une bille, qui remplace la tête du fémur et une cupule qui remplace la cavité de la hanche (dans laquelle tourne la tête lorsqu’on bouge la jambe). Une tige située sous la bille permet d’ancrer la tête artificielle dans le fémur.
Les prothèses les plus simples se composent d’une tige et d’une bille en une seule pièce, en métal, et d’une cupule, en plastique. C’est ici que les choses se compliquent et que les variantes se multiplient. La tige, la bille et la cupule peuvent être réalisées en différents matériaux : métal, céramique ou encore plastique... C’est au médecin qu’appartient le choix de la combinaison la plus adaptée au patient.
1.092 combinaisons
Dans le cadre de l’étude sur les prothèses de la hanche qu’elle vient de réaliser auprès de plus de 50.000 de ses membres, la Mutualité chrétienne a compté pas moins de 1.092 combinaisons différentes pour la tige, la bille, le revêtement de la cupule et la cupule.
» La prothèse de la hanche la plus simple, en deux parties, convient très bien lorsqu’elle est placée chez des personnes très âgées, qui ne la sollicitent pratiquement pas, précise le Pr Christophe Pattyn, chirurgien de la hanche à l’hôpital universitaire de Gand. Dans les autres cas, elle présente des inconvénients. En effet, comme elle est constituée de deux parties, il n’y a pratiquement aucune marge pour l’adapter individuellement au patient : tout ce que le chirurgien peut faire, c’est varier la profondeur à laquelle on ancre la tige dans le canal médullaire du fémur.
En outre, le frottement du métal de la bille sur le polyéthylène de la cupule libère de petites particules de matière synthétique, auxquelles le système immunitaire finit par réagir. Résultat, l’organisme libère des substances qui stimulent la décomposition osseuse. Statistiquement, on enregistre de très bons résultats avec cette prothèse mais ce taux de réussite est trompeur. Il y a dix ans, elle était placée presque exclusivement chez les plus de 75 ans. Or ceux-ci ont aujourd’hui atteint un âge où il est plus risqué de les réopérer. Si ces patients ont perdu de leur mobilité, on laisse leur prothèse en place, du moins s’ils ne sont pas trop incommodés. »
Une hanche en diamant ?
En dépit de ses effets secondaires, le polyéthylène est toujours utilisé pour les prothèses de la hanche. » On utilise désormais un polyéthylène traité thermiquement pour éviter ces phénomènes d’usure. Mais on utilise aussi d’autres matériaux, plus durs, afin de générer le moins de frottement possible entre la bille et la cupule. La céramique, par exemple, est très résistante à l’usure, mais présente l’inconvénient de ne pas être incassable. Jusqu’à présent, on ne peut donc pas s’en servir pour réaliser des billes de grande taille. Or, plus grande est la bille, meilleure est la stabilité de l’articulation. Les billes en métal, un matériau dur, peuvent être plus grandes mais, lorsqu’un frottement, aussi minime soit-il, survient, des particules de métal sont libérées. Jusqu’à présent, on n’a pas encore réussi à prouver qu’elles exercent un effet toxique mais, dans le doute, on préfère jouer la carte de la sécurité. De plus, une prothèse » métal sur métal » peut déclencher une réaction allergique, surtout chez les femmes jeunes.
Chaque matériau présente des avantages et des inconvénients : la solution parfaite n’existe pas. On travaille constamment à améliorer les matériaux et à en trouver de nouveaux. On espère aussi pouvoir réaliser bientôt des billes en céramique plus grandes. Il y a quelques années, il avait même été question d’une prothèse réalisée dans le matériau le plus dur du monde : le carbone pur, c’est-à-dire en diamant ! Mais je ne pense pas que ce soit une option abordable. »
Resurfacing
Pour les opérations de la hanche classiques, on scie généralement la tête du fémur mais on peut l’épargner (partiellement).
» On la recouvre alors d’une capsule, fixée dans l’os. C’est ce que l’on appelle la prothèse de resurfacing. Cette intervention est surtout pratiquée chez les femmes de moins de 50 ans et les hommes de moins de 60 ans. Des personnes qui vont sans doute encore beaucoup solliciter leur hanche et qui ne courent pas encore de risque d’ostéoporose. En effet, l’ostéoporose peut générer des complications (chez les femmes, par exemple, le risque de réaction allergique est plus important que chez les hommes). Le resurfacing est un véritable travail de précision mais, lorsque l’opération réussit parfaitement, les patients peuvent à nouveau faire tout ce qu’ils faisaient avant. »
L’âge et le sexe ne sont pas les seuls éléments qui déterminent le type de hanche artificielle qu’on utilisera. » Le niveau d’activité et le mode de vie jouent également un rôle de premier plan. Une personne âgée de plus de 70 ans et très sportive ne se verra pas proposer la même prothèse qu’une personne du même âge qui mène une vie beaucoup plus sédentaire. »
Avec ou sans ciment
Outre la diversité des matériaux, il faut encore choisir entre deux techniques de pose : la prothèse cimentée et la prothèse non cimenté. » La prothèse est parfois fixée à l’os avec une sorte de ciment, explique le Pr Pattyn. Mais on peut également travailler sans ciment, l’objectif étant que la prothèse s’intègre littéralement dans l’os. Ou de manière hybride, ce qui signifie que l’une des deux parties (la tige ou la cupule) est cimentée, et l’autre pas. Travailler sans ciment présente l’avantage que la prothèse adhère généralement mieux. Inversement, la couche de ciment doit durcir pendant environ un quart d’heure : l’opération prend donc davantage de temps, ce qui augmente automatiquement le risque de complications.
Le ciment est appliqué sous pression, ce qui pourrait provoquer une embolie mais, afin de prévenir les inflammations, on ajoute des antibiotiques au ciment. Le ciment peut être indiqué lorsque l’os est de mauvaise qualité. Il faut donc vraiment déterminer la meilleure combinaison (méthode – matériau) au cas par cas. »
Des progrès constantsL’étude sur les prothèses de la hanche réalisée par les Mutualités chrétiennes fournit des chiffres intéressants, ne serait-ce que parce qu’elle fait suite à une étude similaire, réalisée en 2000. Les résultats peuvent donc être comparés et les progrès de la technologie sont très perceptibles :
|
Vivre avec une prothèse
Quelle que soit la solution technique retenue, après la pose d’une prothèse de la hanche, il faut prévoir une période de rééducation. Voici comment elle se déroule lorsqu’il n’y a pas de complications.
Après 1 jour : on doit porter des bandages ou des bas de contention. Premiers exercices de kiné à l’hôpital, en position couchée. On apprend ensuite à se laver et à s’habiller seul, puis à sortir du lit, à marcher avec des béquilles... sans forcer la hanche fraîchement opérée.
Après 5 à 10 jours : on peut quitter l’hôpital. Commence alors la deuxième phase de la rééducation, à la maison ou dans un centre de revalidation. On renforce les muscles qui assurent la stabilité de la hanche, en épargnant les muscles et des ligaments qui ont été mis à rude épreuve pendant l’opération. La période de rééducation dure environ 6 semaines.
Après 1 semaine à la maison : on peut recommencer à vivre normalement et à sortir. Après 1 mois : on ne doit plus porter de bandages ou de bas de contention.
Après 4 à 6 semaines : on peut à nouveau conduire une voiture.
Après 8 à 12 semaines : on peut à nouveau rouler à vélo et on ne souffre plus de douleurs post-opératoires.
Après 12 semaines : on peut à nouveau librement se pencher, se tourner ou croiser les jambes, tout en veillant à éviter les luxations.
Toujours : on veille à soigner le plus rapidement possible les infections des voies respiratoires, de la cavité buccale ou de la peau. En effet, elles peuvent être à l’origine du développement d’un foyer infectieux au niveau de la prothèse. Lors d’un resurfacing, la tête du fémur est recouverte d’une capsule en métal. La cupule remplace la cavité de la hanche. La cupule peut être cimentée, ou non. La cupule peut être revêtue d’un matérieau spécifique. Une bille remplace la tête du fémur. Si nécessaire, on peut aussi adapter la liaison entre la tige et la bille. La tige peut être cimentée dans l’os, ou non.
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici